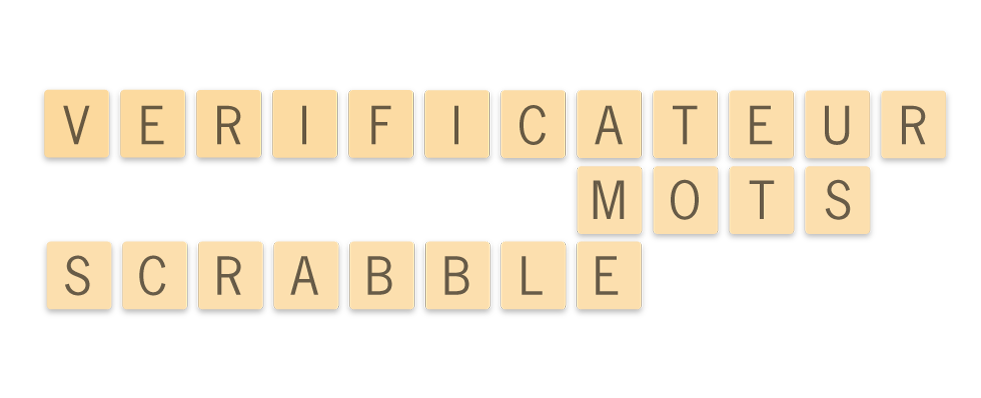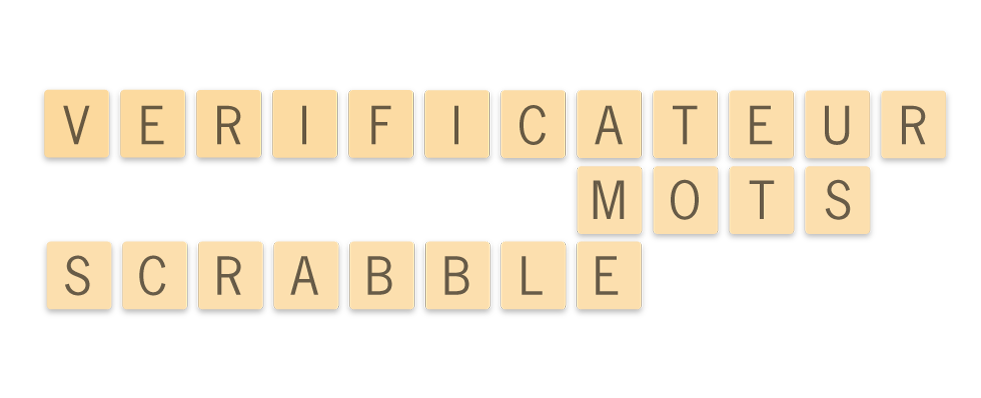Définition(s) :
- Qui appartient à tous, qui concerne tout le monde, à quoi tous ont droit ou part : Les parties communes d'un immeuble.
- Qui est propre au plus grand nombre ; général, public : L'intérêt commun.
- Qui appartient à plusieurs choses ou personnes, qui est simultanément le fait de plusieurs choses ou personnes, ou qu'on partage avec d'autres : Point commun à deux lignes. S'associer à l'effort commun.
- Qui se rencontre fréquemment, qui n'est pas rare ; abondant ou habituel, répandu, ordinaire, courant : L'aubépine est commune dans les haies.
- Qui manque de distinction, d'élégance ; vulgaire : Il a des manières très communes.
- AstrologieSe dit de chacun des quatre signes précédant les équinoxes et les solstices (Gémeaux, Poissons, Sagittaire et Vierge).
- InformatiqueSe dit d'un paramètre ou d'une variable gardant une même valeur dans divers sous-programmes d'un même programme.
- Linguistique Se dit de la langue usuelle, par opposition aux langages techniques. En linguistique historique, se dit d'un état de langue, généralement non attesté, qui serait celui de la langue considérée avant sa différenciation en dialectes.
- Littéraire. Le plus grand nombre, la généralité : Le commun des lecteurs aime ce genre de livres.
- HistoireEnsemble des personnes qui formaient le service des grandes maisons.
- Qui sert, qui peut servir à tout le monde ou seulement à plusieurs personnes.
- Partagé par différents êtres ou par différentes choses.
- (En particulier) Mutuel, réciproque.
- Public, collectif.
- Général, ordinaire, habituel, Moyen ; qui appartient ou peut appartenir à la plupart des hommes ou à un grand nombre d’hommes.
- Répandu et abondant ; fréquent, courant.
- (En particulier) (Mathématiques) Définition manquante ou à compléter. (Ajouter)
- (Géométrie) Ce qui appartient à la fois à deux figures que l’on compare.
- (Droit) Relatif à une communauté de biens.
- (Linguistique) Qualifie les mots, les termes ordinaires d’une langue, par opposition à ceux qui ne sont usités que dans les arts et dans les sciences.
- (Linguistique) Qualifie la langue qui est parlée le plus généralement dans un pays, ou parfois sert de langue d'échange (koiné).
- Qui est médiocre, qui ne sort pas de l’ordinaire, qui est peu estimable dans son genre.
- De peu de valeur et d’une qualité médiocre.
- Vulgaire, bas, par opposition à noble, distingué.
- Société entre deux ou plusieurs personnes.
- Le plus grand nombre, la plus grande partie.
- Peuple.
- (Liturgie) L’office général des apôtres, des martyrs, etc., pour qui l’église n’a point réglé d’office particulier.
- (Au pluriel) Bâtiments annexes qui servent aux cuisines, aux garages, aux écuries et généralement aux différentes parties du service.
- (Grammaire) Genre présent dans certaines langues, particulièrement germaniques, exprimant que la terminaison est la même au masculin et au féminin [2].
- Qui est le fait de plusieurs.
- Qui appartient à deux ou plusieurs.
- Qui appartient au public, à la société.
- Réalisé à plusieurs.
- Habituel, se rencontrant de façon courante, ordinaire.
- Trivial, vulgaire.
- Comparable à.
- La plus grande partie.
- Ensemble des bâtiments annexes d'une propriété, d'un château.
- Sens 1: Qui est de participation à plusieurs ou à tous. L'air, la lumière sont communs. La maison commune, l'hôtel de ville. Terres communes, terres qui, n'ayant pas de possesseur particulier, servent aux usages d'une communauté, dans le territoire de laquelle elles se trouvent situées. Des amis communs, des amis qui le sont des deux parties. Le droit commun, la loi établie dans un état, l'usage général. Terme de jurisprudence. Dont la jouissance est permise à plusieurs personnes à titre égal. Escalier, puits, chemin commun. Jugement ou arrêt commun, jugement exécutoire contre une personne qui n'a point été mise en cause ou qui a fait défaut, aussi bien que contre la partie qui a comparu. Époux communs en biens, époux mariés sous le régime de la communauté. Choses communes, les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété publique ou privée comme l'air, la mer. En termes de palais et de généalogie, l'auteur commun des parties, se dit quand on parle du père de deux frères ou sœurs qui plaident ensemble. En arithmétique, diviseur commun, nombre qui divise exactement deux ou plusieurs autres nombres. 4 est un diviseur commun de 36, de 28 et de 52. Le plus grand commun diviseur, le plus grand de tous les diviseurs communs à deux ou plusieurs nombres. Ainsi 84, 42, 56, ont pour diviseurs communs 2, 4, 7, 14. Ce dernier est le plus grand commun diviseur des trois nombres donnés. Dénominateur commun, celui qui appartient à plusieurs fractions données ou réduites au même dénominateur. Terme de physique. Réservoir commun, en parlant de l'électricité, la terre où s'écoule et d'où semble sortir toute l'électricité sensible produite par nos machines. Terme de géométrie. Qui appartient à la fois à deux figures que l'on compare.
- Sens 2: Qui se fait en société, ensemble ; qui est conjoint. À Sparte les repas des hommes étaient communs. Le travail commun resserre leur union. Un commun naufrage. Faire cause commune, se dit de personnes qu'un intérêt, un motif quelconque pousse à réunir leurs efforts, à combattre pour un même objet. Faire bourse commune, se dit de personnes mettant ensemble l'argent qu'elles ont ou qu'elles gagnent, et vivant ainsi avec l'avoir les uns des autres. Faire vie commune, vivre à frais communs. La vie commune, la vie des communautés. Avoir quelque chose de commun avec, n'avoir rien de commun avec, avoir ou n'avoir pas des analogies, des rapports, des ressemblances avec.
- Sens 3: Général, public. L'intérêt commun. L'opinion commune. La langue commune, la langue qui se parle le plus généralement dans un pays. En Alsace, l'allemand est la langue commune. D'un commun accord, de concert, sans opposition aucune. D'une commune voix, unanimement. La voix commune, l'opinion générale. Faire preuve par la commune renommée, c'est-à-dire par l'opinion publique, au moyen d'une enquête.
- Sens 4: Ordinaire. Devenir d'un usage commun. À la mode commune. La vie commune, les mœurs générales, les événements ordinaires de la vie. Sens commun, faculté de juger raisonnablement des choses, en tant qu'elle appartient à la plupart des hommes. Les mots, les termes communs de la langue, ceux qui sont usuels entre tout le monde, par opposition aux termes techniques. Style commun, style qui n'a rien de remarquable ni d'élégant. Vers commun, vers de dix syllabes, ainsi nommé par opposition au grand vers ou vers alexandrin, qui est de douze syllabes, et au petit vers, qui est de huit syllabes. Le commun peuple, le vulgaire. Expédier en forme commune, en style de la daterie de Rome, expédier sans grâce et sans remise ; et, figurément, être expédié en forme commune, éprouver un sort fâcheux, une malencontre, perdre tout son argent au jeu, mourir entre les mains de mauvais médecins, etc. Délit commun, se disait d'un délit commis par un ecclésiastique et justiciable du juge ecclésiastique, par opposition à cas privilégié.
- Sens 5: Fréquent, abondant, qu'on trouve facilement. Les bons muscats sont communs en Languedoc.
- Sens 6: Qui ne s'élève pas au-dessus du niveau ordinaire.
- Sens 7: Privé de noblesse, de distinction. Il a l'air commun, la figure commune.
- Sens 8: Terme de grammaire. Nom commun ou substantif appellatif, celui qui convient à tous les individus de la même espèce ; homme, cheval sont des noms communs.Nom commun ou épicène, nom qui change de genre, ou nom qui convient aux deux sexes : un bel enfant ou une belle enfant ; une perdrix, qui se dit également du mâle et de la femelle. Adjectif commun, adjectif qui, comme fidèle, a la même terminaison au masculin et au féminin. Syllabe commune, syllabe qui, dans les langues où la quantité des syllabes fait le vers, peut être longue ou brève. Terme de grammaire grecque. Verbes communs, verbes qui ont à la fois le sens actif et le sens passif, avec la terminaison passive. Dialecte commun, par opposition aux dialectes locaux, la langue littéraire commune à tous les écrivains grecs après Alexandre. Terme de rhétorique. Lieux communs, sorte de points principaux, auxquels les anciens rhéteurs rapportaient toutes les preuves dont ils faisaient usage dans leurs discours ; et par extension et en mauvaise part, idées usées, rebattues, pensées ou expressions banales. Il ne dit que des lieux communs.
- Sens 9: Année commune, l'une portant l'autre, bon an, mal an. S. f.: Terme de bourse. Faire une commune ou moyenne, se dit d'une personne, qui, après avoir acheté des valeurs à un prix, les voit subitement baisser, sans que son opinion sur la hausse ait changé ; qui alors achète en baisse la même quantité de valeurs qu'elle possède déjà (ce qui diminue le prix de revient de la totalité) ; et qui, quand la hausse reprend, vend aussitôt que les cours ont atteint ce nouveau prix de revient sans attendre, au risque de ne pas le revoir, son prix d'achat primitif.
- Sens 10: S. m.: Le commun, ce que deux ou plusieurs personnes mettent en société. Il faut prendre cette dépense sur le commun.Vivre sur le commun, vivre aux frais d'une société, sans rien faire ; et aussi, vivre sur le tiers et le quart. En commun, loc. adv.: De société, de concert. Vivre, travailler en commun.
- Sens 11: Le plus grand nombre, la généralité. Le commun des lecteurs. Cette chose est du commun, elle n'a pas grand prix.
- Sens 12: La roture, les basses classes. Terme de liturgie. Le commun des martyrs, les martyrs pour lesquels l'Église prie en masse ; et fig. Il est du commun des martyrs, c'est un homme que rien ne distingue.
- Sens 13: Le commun chez les rois, chez les princes et les grands, nom collectif qui signifie les bas officiers. Il a mangé à la table du commun.Chez le roi, grand commun, les offices destinées à la nourriture de la plupart des officiers de la maison du roi. Petit commun, certaines offices détachées du grand commun pour la nourriture de quelques officiers privilégiés de la maison du roi.
- Sens 14: Dans les grandes maisons, les communs, les bâtiments affectés aux cuisines, écuries, remises, etc.
- Sens 15: Les communs se dit dans quelques provinces pour les commodités.
- Société entre deux ou plusieurs personnes.
- Le plus grand nombre, la plus grande partie.
- Peuple.
- (Liturgie) L’office général des apôtres, des martyrs, etc., pour qui l’église n’a point réglé d’office particulier.
- (Au pluriel) Bâtiments annexes qui servent aux cuisines, aux garages, aux écuries et généralement aux différentes parties du service.
- (Grammaire) Genre présent dans certaines langues, particulièrement germaniques, exprimant que la terminaison est la même au masculin et au féminin [2].
- (Économie) Ressource commune partagée suivant certains droits établis par une structure de gouvernance.
- (Électronique) potentiel, souvent nul, partagé entre plusieurs composants.
- Qui sert, qui peut servir à tout le monde ou seulement à plusieurs personnes.
- Partagé par différents êtres ou par différentes choses.
- (En particulier) Mutuel, réciproque.
- Public, collectif.
- Général ; ordinaire ; habituel ; moyen ; qui appartient ou peut appartenir à la plupart des hommes ou à un grand nombre d’hommes.
- Répandu et abondant ; fréquent ; courant.
- (En particulier) (Mathématiques) Propriété valable pour plusieurs nombres ou entités.
- (Géométrie) Ce qui appartient à la fois à deux figures que l’on compare.
- (Droit de la copropriété) Relatif à une communauté de biens.
- (Linguistique) Qualifie les mots, les termes ordinaires d’une langue, par opposition à ceux qui ne sont usités que dans les arts et dans les sciences.
- (Linguistique) Qualifie la langue qui est parlée le plus généralement dans un pays, ou parfois sert de langue d'échange (koiné).
- Qui est médiocre, qui ne sort pas de l’ordinaire, qui est peu estimable dans son genre.
- De peu de valeur et d’une qualité médiocre.
- Vulgaire, bas, par opposition à noble, distingué.
Points au Scrabble
Rapporte 10 points (sans les contraintes du jeu.)